Jusqu’ici, je n’avais pas pleuré. Ou alors, je ne m’en étais pas rendu compte.
Pour la quatrième fois, peut-être la cinquième – j’avais arrêté de compter – Brothers in Arms, la chanson de Dire Straits, résonnait religieusement dans cet endroit déconcertant, qui avait tout d’une chapelle ou d’une église, sans pour autant en porter le nom. Il y avait bien les bancs, le pupitre, les fleurs, les vitres décorées… Le cercueil. Mais les murs étaient peints dans une couleur pastel qui semblait hors de propos. Le carrelage blanc cassé était froid, impersonnel, comme celui de l’hôpital. On percevait là toute l’ironie des obsèques laïques, bien incapables de s’affranchir des codes religieux, tant l’inconscient collectif les a assimilés au deuil.
La chanson Brothers in Arms commence par un long solo de guitare électrique d’une trentaine de secondes, qui suffisaient à elles seules pour imprégner les lieux d’une ambiance solennelle et accablante : une atmosphère de recueillement. On nous avait demandé, à ma sœur et à moi, de sélectionner cinq titres. Cinq chansons, pour autant de « moments » au cours de la cérémonie. C’était l’usage, semblait-il, en tout cas ça l’était dans ce crématorium, ce funérarium… Je n’étais pas trop sûr de la manière dont on devait appeler ce lieu. Cinq chansons. Il était déjà bien mal aisé de cerner les goûts de mon père de son vivant : encore aurait-il fallu que lui-même reconnaisse en avoir. Aucun doute quant à ce qu’il n’aimait pas : il le faisait savoir sans aucune retenue ; mais rien sur ce qu’il aimait ; encore moins sur ceux qu’il aimait. Nous ne savions jamais quoi lui offrir, pour son anniversaire, pour la fête des pères, pour Noël. Quand nous lui posions la question, il avait coutume de nous répondre, sur le ton de la blague : « Moi, je ne veux rien, car le plus beau cadeau que vous puissiez m’offrir, c’est que vous soyez heureux. » Nous aurions pourtant eu bien du mal à le lui promettre, ce bonheur auquel il n’avait, pour sa part, jamais contribué. C’était malheureux, mais aucun de nous deux n’avions suffisamment parlé avec notre père pour savoir ce qui l’animait. Quant à savoir ce qu’il aurait souhaité après sa mort… Sans doute n’aurait-il rien voulu. Car il y avait bien une chose à ce sujet, une pensée dont il avait, semble-t-il, trouvé opportun de la partager avec ses enfants : il avait toujours prétendu n’avoir que faire de ce qu’on ferait de lui après sa mort. Il voulait être incinéré, c’était certain, mais il ne voulait surtout pas d’endroit où l’on aurait pu se recueillir. Il refusait l’idée d’un lieu identifié à tout jamais comme l’endroit où il reposerait. « Si c’était possible, je ne voudrais même pas que vous puissiez savoir où sont mes cendres ». Sans doute savait-il, au fond de lui, que si un tel lieu existait, ses propres enfants ne viendraient jamais s’y recueillir. Sans doute préférait-il donc l’idée que pareil lieu n’existe guère.
Bref, nous n’avions pas cinq chansons, alors nous n’en avions qu’une : c’était Brothers in Arms, de Dire Straits. Dire Straits, parce qu’il aimait ce groupe, ça, nous le savions, cela faisait partie de ces quelques bribes connues sur notre père, auxquelles nous pouvions nous raccrocher tant bien que mal. Brothers in Arms, c’était l’idée de ma sœur. Non pas que mon père ait eu une affection particulière pour cette chanson, mais nous avions convenu elle et moi d’en choisir une que nous n’écoutions jamais, pour ne surtout pas teinter d’un souvenir douloureux une chanson qui nous plaisait. Je ne savais pas encore que par la suite, je l’écouterais à nouveau, dans une dernière, mais toujours aussi vaine tentative de m’approcher de mon père. Enfin, les paroles, racontées du point de vue d’un soldat à l’agonie, semblaient se prêter à la situation. Bien sûr, mon père n’avait rien d’un guerrier mort avec courage en défendant sa patrie au front, ce n’était rien d’autre qu’un homme d’une cinquantaine d’années, qui s’était laissé mourir aussi sinistrement qu’il s’était laissé vivre. Mais il y avait bien ces deux vers : Let me bid you farewell / Every man has to die. Oui, tous les hommes doivent mourir. Toujours était-il que la chanson nous avait semblé appropriée. En tout cas, ma tante me l’avait dit : « Vous avez bien fait de choisir cette chanson ». Tant mieux, la supercherie fonctionnait : je ne voulais surtout pas montrer que cette cérémonie n’avait guère d’importance à mes yeux.
C’est fou, tout ce que l’on vous demande de décider lorsque quelqu’un meurt. C’était pourtant une cérémonie laïque – mon père était un anticlérical convaincu – mais l’organisation était tout aussi rigoureuse et formelle que celle d’une messe. On nous avait demandé de choisir sa dernière tenue. On nous avait demandé s’il fallait imprimer une photo de plage sur l’urne funéraire. On nous avait demandé s’il fallait projeter un diaporama pendant la cérémonie. On nous avait même demandé la couleur des poignées sur le cercueil, et celle du matelassage, à l’intérieur. Nous avions dit : « Peu importe », car cela n’avait aucune valeur symbolique pour nous. La dame avait répondu : « Bon, eh bien ivoire alors : ça va avec tout ». La phrase avait manqué de nous faire exploser de rire. « Ça va avec tout ». Comme si l’on parlait du dernier accessoire à la mode et non du cercueil de mon père !
Mais tout cela était acté, désormais, et cette énième boucle de Brothers in Arms signalait le moment où chacun était invité à se lever pour se recueillir devant le cercueil, et du geste de son choix, rendre à mon père un dernier hommage. Et nous, ses enfants, allions devoir en être les spectateurs, le temps qu’arrive notre tour.
Il y eut des connaissances plus ou moins éloignées de mon père et de ma famille. Certaines personnes dont il était évident qu’elles devaient être là, d’autres visages dont je m’étonnais que mon père ait eu un impact aussi fort dans leur vie. Certains dont je me demandais s’ils étaient là pour honorer mon père ou pour nous soutenir, nous.
Il y eut le meilleur ami de mes parents, dont le chagrin me causa beaucoup de peine. C’était connu dans la famille, et l’on avait coutume de s’en moquer gentiment : il était particulièrement sensible. Je ne m’étonnai donc pas de le voir pleurer ; ce qui me chagrina, c’est de saisir combien mon père avait dû compter pour lui. Il y eut son épouse, et ce fut un spectacle plus difficile encore, car elle pleurait aussi, alors qu’elle, c’était la boutade inverse, avait la réputation d’une personne intériorisant ses émotions. Mais voilà qu’elle pleurait, elle aussi. Tout le monde pleurait. Mais pas moi. Toujours pas. Pourquoi donc étaient-ils tristes ? Ainsi, mon père allait vraiment leur manquer.
Et enfin, il y eut une personne dont la tristesse fut celle qui m’en causa le plus. C’était son patron. Mon père avait travaillé dans son entreprise pendant dix ans. Je ne l’avais jamais rencontré avant ce jour. Ses larmes étaient parmi les plus abondantes. Ma sœur et moi l’ignorions alors, mais l’immense gerbe de fleurs qui trônait à côté du cercueil de mon père – la plus grande et la plus imposante de toutes, sans doute la plus coûteuse, aussi – avait été offerte par ses collègues et son patron. Les fleurs étaient accompagnées d’un mot, manuscrit, signé de tous leurs prénoms, qui disait en ces mots : « Nous avons perdu un homme d’une grande humanité, à la joie de vivre communicative. » La lecture de cette phrase serait pour moi un choc. Je croiserais alors, désemparé, le regard de ma grande sœur, et sans que nous ayons besoin de nous dire quoi que ce soit, nous partagerions alors la même pensée : mais de qui parlaient-ils ? Qui était donc cet homme qui se révélait devant ses collègues sous un jour qu’il n’avait jamais montré à ses propres enfants ? Rien, dans la description de cette personne lumineuse et solaire, ne correspondait au père que nous avions connu.
Mais cette lecture devrait encore attendre un peu, le temps que la cérémonie se termine, le temps que tout le monde passe devant le cercueil pour un dernier hommage.
Ses amis.
Ses collègues.
Ses connaissances.
Sa famille.
Sa sœur.
Ma mère.
C’était à nous.
Personne n’en avait convenu, et pourtant le protocole semblait s’imposer de lui-même : c’était à nous qu’il incombait de nous recueillir en dernier.
Ma sœur, et moi. Ses enfants.
Les pauvres, pauvres, pauvres orphelins. Ou en tout cas étaient-ce les mots que j’avais l’impression d’entendre, alors pourtant que l’assistance réunie derrière nous était totalement muette.
Tout le monde était retourné à sa place. Tout le monde s’était assis. Tout le monde regardait droit devant soi. Brothers in Arms continuait de jouer. Et c’était nous que l’on regardait, les deux enfants du défunt. Je sentais tous ces regards fixés sur nous, tandis qu’un pas après l’autre, nous nous approchions du cercueil de notre père.
Nous nous arrêtâmes devant. Je ne sais plus qui initia le geste, mais ma sœur et moi nous prîmes la main.
Et c’est là, devant ce cercueil, dans cet ultime moment de confrontation avec mon père, que tout le poids des questions que l’on m’avait posées, des souvenirs que j’avais enfouis et des émotions que j’avais ressenties, revint me frapper en pleine face. Le temps se figea tandis que se libéraient toutes ces pensées que j’avais scellées. C’est alors qu’enfin je fondis en larmes. Je pleurai devant ce cercueil, pliant sous le poids de tous les regards braqués sur moi, qui ne me semblaient pas être ceux des personnes présentes dans la salle, mais ceux du monde tout entier.
Me revinrent en échos cris et disputes, excès et colères, drames et mauvaises fois.
Des critiques gratuites, des répliques cinglantes.
Des vacances gâchées, des larmes causées par sa faute.
Des angoisses. Des complexes. Des terreurs.
Je me souvins de cette légendaire anecdote familiale selon laquelle mon père, alors que je n’étais qu’un bébé, m’avait cassé un jouet pour me punir d’avoir cassé un vase. Mon père était fier de raconter cette histoire, comme s’il y avait là matière à se réjouir.
Je revis tous ces trajets passés dans le silence pesant de sa camionnette blanche, lorsqu’il venait me chercher après les cours et que nous étions bien incapables d’échanger le moindre mot. Nous n’avions jamais rien eu à nous dire.
J’entendis sa voix ironique railler, se moquer, tourner en dérision ses propres amis, sa propre famille, sa femme, ses enfants.
Je revis les verres, ceux qui se remplissaient de pastis, et ceux qui volaient en éclats. Je vécus à nouveau les crises parentales, les menaces de divorce. Je me remémorai la voiture de ma mère, ce jour où nous y avions jeté à la hâte toutes nos possessions, prêts à quitter mon père pour toujours – avant, bien sûr, de revenir vivre avec lui quelques semaines plus tard, tous ensemble, en devant faire comme si de rien n’était, et jouer à la parfaite petite famille.
Je réentendis, ou plutôt j’entendis pour la première fois, deux mots qu’il m’avait un jour jetés au visage sans que je les entende. Une insulte crachée à ma figure, dont mon cerveau avait fait abstraction, si bien que c’était ma sœur qui avait dû me les rappeler des années plus tard : « petit pédé ». Ma mémoire m’en avait jusqu’alors préservé.
Une voix dans ma tête : la sienne. Cette voix intérieure, que j’entendis hier, que j’entends aujourd’hui, que j’entendrai demain, que j’entendrai toujours. « Tu n’es bon à rien, tu es nul, tu es moyen, tu es maladroit, tu n’es pas beau. »
Une autre voix : celle de ma mère, à la sortie de la chambre d’hôpital, quelques jours plus tôt. « Pourquoi tu ne lui as pas dit je t’aime ? ». Je n’avais répondu qu’en pensée : « Parce que je ne l’aime pas. » Était-ce un crime ? Pendant toue la maladie de mon père, je m’en étais voulu de ne pas arriver à prononcer ces mots devant lui : « Je t’aime ». Plus tard, j’appris à renverser la culpabilité. Que penser de cet homme qui, devant l’imminence inéluctable de la mort, n’en avait guère profité pour rattraper le temps perdu, se rapprocher de ses enfants, et leur dire qu’il les aimait ? Il n’en avait rien fait. Au contraire, jusque dans ses derniers jours de conscience, il avait été une version exacerbée de lui-même, une parfaite amplification de ses pires excès.
Une autre voix, plus chorale : celle de mes parents, de mes amis, de tout le monde. « Tu ressembles à ton père ». C’était vrai. Ça avait toujours été vrai, c’était de plus en plus vrai, et cela me frapperait encore, parfois, en croyant l’apercevoir dans le reflet du miroir. Comme une ironique fatalité collée à mon visage, une épée de Damoclès flottant au-dessus de ma tête : une angoisse appelée à me poursuivre encore et encore à chaque fois que son visage me regarderait dans le miroir. Ma crainte la plus vive : l’éventualité terrifiante de devenir un jour comme lui.
Bientôt, on allait pousser ce cercueil derrière une porte, le feu le réduirait en cendres, et de mon père, il ne resterait plus rien. Mais les flammes continueraient de brûler, de gagner en intensité, et rien ne pourrait les étouffer.
En mourant, mon père chargeait mes épaules d’un dernier fardeau – un de plus. Elle allait me suivre, cette peine, traînant avec elle le sentiment de ne pas être suffisamment fort, celui de ne jamais être à la hauteur, l’impression que ma tristesse était illégitime. La douleur d’être moyen dans tout, de n’être bon dans rien. Le sentiment d’avoir une vie médiocre, teintée de sa nuisance, de sa négativité, voilée d’un filtre opacifiant, rendant le bonheur invisible et inaccessible.
À compter de cet instant, et pour longtemps, il me serait impossible de me remémorer le moindre souvenir heureux de mon père. Peut-être n’y en avait-t-il jamais eu. Peut-être, surtout, n’avaient-ils jamais autant compté que les souvenirs malheureux. On m’avait dit : « Tu verras, on ne se souvient pas de la mort en elle-même. Le temps passe, et ce sont les souvenirs heureux dont on se souvient, les moments de vie, pas la vision de la mort. » Dans mon cas, rien n’avait été plus faux. Je ne crois pas avoir de souvenir plus vif que celui de cette dernière conversation que j’ai eue avec lui – sans doute la seule vraie conversation – et elle eut lieu dans sa chambre d’hôpital, alors que, déjà, la mort l’avait emporté, et qu’il ne pouvait plus rien répondre. De son vivant, je ne retiens que la douleur. La mienne, mais aussi la sienne, car nul doute qu’il faut être bien malheureux pour consacrer sa vie à tirer les autres vers le bas. Quant à sa mort, elle reste bien présente dans mon esprit. Brothers in Arms, exactement comme elle le fit ce jour-là, revint me hanter régulièrement, et continua de jouer en boucle dans ma tête. Il me faudrait raconter cette histoire mille fois, sans jamais trouver les mots justes pour la dire, et malgré cela, rien ne soulagerait la douleur.
J’eus la terrible impression que mon chagrin n’était pas à la hauteur du soutien que cette salle m’apportait. Je ressentis un décalage vertigineux entre la peine que l’on m’imaginait ressentir alors, celle d’avoir perdu mon père, et l’espoir que j’avais réellement perdu, celui de trouver mon père un jour. Je pleurais, je pleurais sous les regards éplorés. Et en dedans, je me disais : « S’ils savaient ». « S’ils savaient, en me voyant m’effondrer devant ce cercueil, serrant fort la main de ma sœur, s’ils savaient, que je ne pleure pas une seule larme parce que je suis devenu orphelin, mais que je pleure parce que je le suis depuis toujours. » Là, devant ce cercueil, et pour le restant de mes jours, je devais me résoudre non pas à l’idée que mon père n’était plus, mais bien malheureusement qu’il n’avait jamais été.
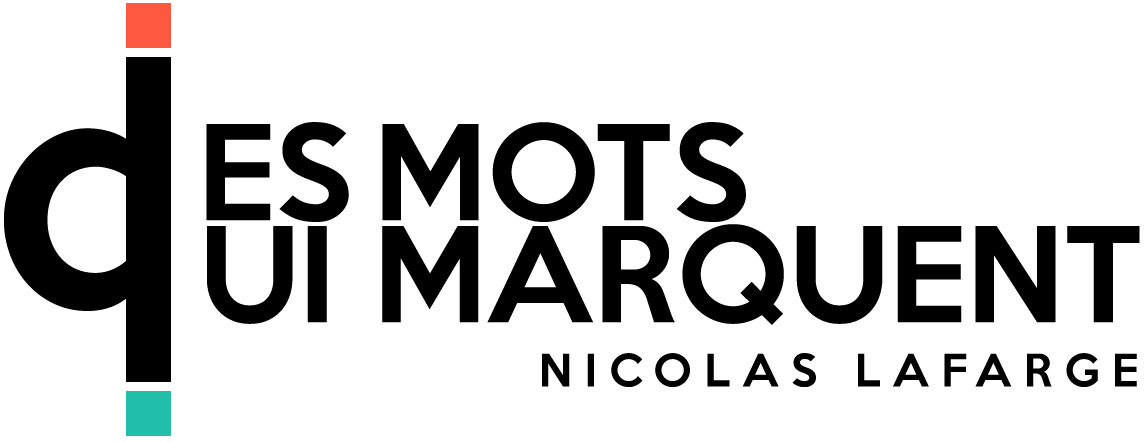
Merci pour ce texte poignant. Au-delà des faits racontés, au-delà même de ton expérience douloureuse, je garde le ton du vrai, de la sincérité. Ton texte est beau parce qu’il est vrai. Il ne demande ni approbation, ni désaccord. Et surtout pas de leçon de morale !
Je voudrais simplement te prendre dans mes bras. J’ai appris petit à petit à me battre avec des souvenirs et des pensées très sombres. Parfois j’ai même triomphé ! Je pensais que les faits réels, les événements vécus, et le monde environnant, pouvaient décider de mon orientation générale dans la vie, parce que les pensées qu’ils m’inspiraient se gravaient en moi comme des lettres de feu et qu’il m’était impossible d’y échapper. Je pensais que le fardeau ne faisait que s’alourdir, années après années. Mais j’avais tort.
Je voudrais te prendre dans mes bras quelques minutes, et puis ensuite nous aurions une discussion amicale lumineuse, drôle, stimulante et irrévérencieuse. Nous célébrerions la vie si imparfaite. Avec beaucoup de joie de la vivre ! Qu’en dis-tu ?
Michel
Merci Michel pour ton commentaire, ça me touche beaucoup ce que tu dis ! En particulier ceci : « Il ne demande ni approbation, ni désaccord. Et surtout pas de leçon de morale ! » Je crois que si ce texte a été aussi difficile à écrire, et à partager, c’est par crainte de cela : que ce ressenti soit « indicible », qu’il fasse partie de ces pensées que l’on (s’)ordonne de ne pas dire, parce qu’il faut honorer la mémoire de…, parce qu’il ne faut pas faire de mal à… – peut-être parce que j’avais un peu honte, aussi, de penser toutes ces choses-là. J’ai eu beaucoup peur, aussi, que peut-être ce texte soit trop intime et que l’on m’en fasse le reproche, d’avoir voulu attirer l’attention, d’avoir voulu mettre en scène une douleur. Alors qu’au contraire, je crois que toute la démarche d’écriture de ce texte, c’était plutôt pour moi une manière de « changer la boue en or », de faire de cet épisode de ma vie un texte dont je puisse être fier, et que je trouve « beau », d’une certaine manière. Une façon de tourner la page de façon assez littérale. Ton expérience personnelle est inspirante et j’espère que je ferai le même constat que toi d’ici quelques temps. En attendant, je continuerai d’écrire, car c’est, je pense, quoi que j’écrive, ce qui me fait le plus de bien ! Et oui, au plaisir d’en rediscuter avec toi, un jour prochain.