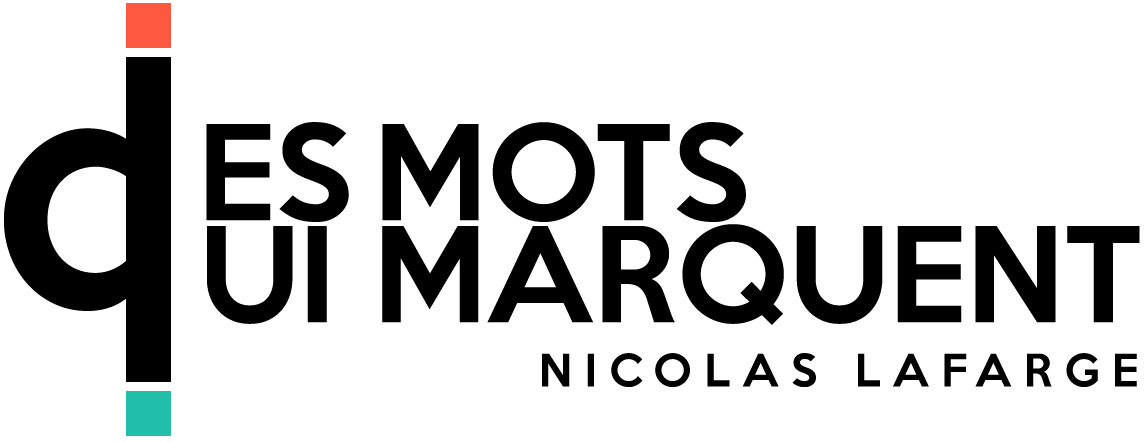On passe notre temps — on, c’est moi, c’est toi, c’est ta mère, c’est ton père, c’est ta collègue, ton patron, ton boulanger, ton président de la République ; on, c’est nous tous, partout, tout le temps —, on passe le plus clair de notre vie, en fait, à porter le masque de quelqu’un que rien n’atteint. On ne veut surtout pas dire que l’on est démotivé par son travail, on refuse de parler de cette boule dans le ventre quand on se rend à son bureau, au risque d’avoir l’air d’un fainéant. On ne veut surtout pas être le premier à dire « je t’aime », ne surtout pas s’engager trop vite, ne surtout pas s’engager du tout, car la peine de cœur se révèle un mal dont on doit se prémunir comme d’une maladie mortelle. On ne veut surtout pas montrer que l’on est fatigué, d’être un père, d’être une mère, d’être un époux, d’être un fils, d’être humain, tout court. Alors on verrouille tout. On ferme les portes et on les cadenasse à double tour. Mais ce faisant, on oublie que les émotions ne se sélectionnent pas. On ne peut désirer tout sans son contraire, la joie sans la tristesse, l’excitation sans la peur, l’amour sans le deuil, la passion sans la jalousie. À vouloir enfermer ses peines et ses chagrins, on se prive aussi des bonheurs et des plaisirs. Que devenons-nous ainsi sinon des machines ? Qui peut se sentir vivant, sans accepter d’être vulnérable ?